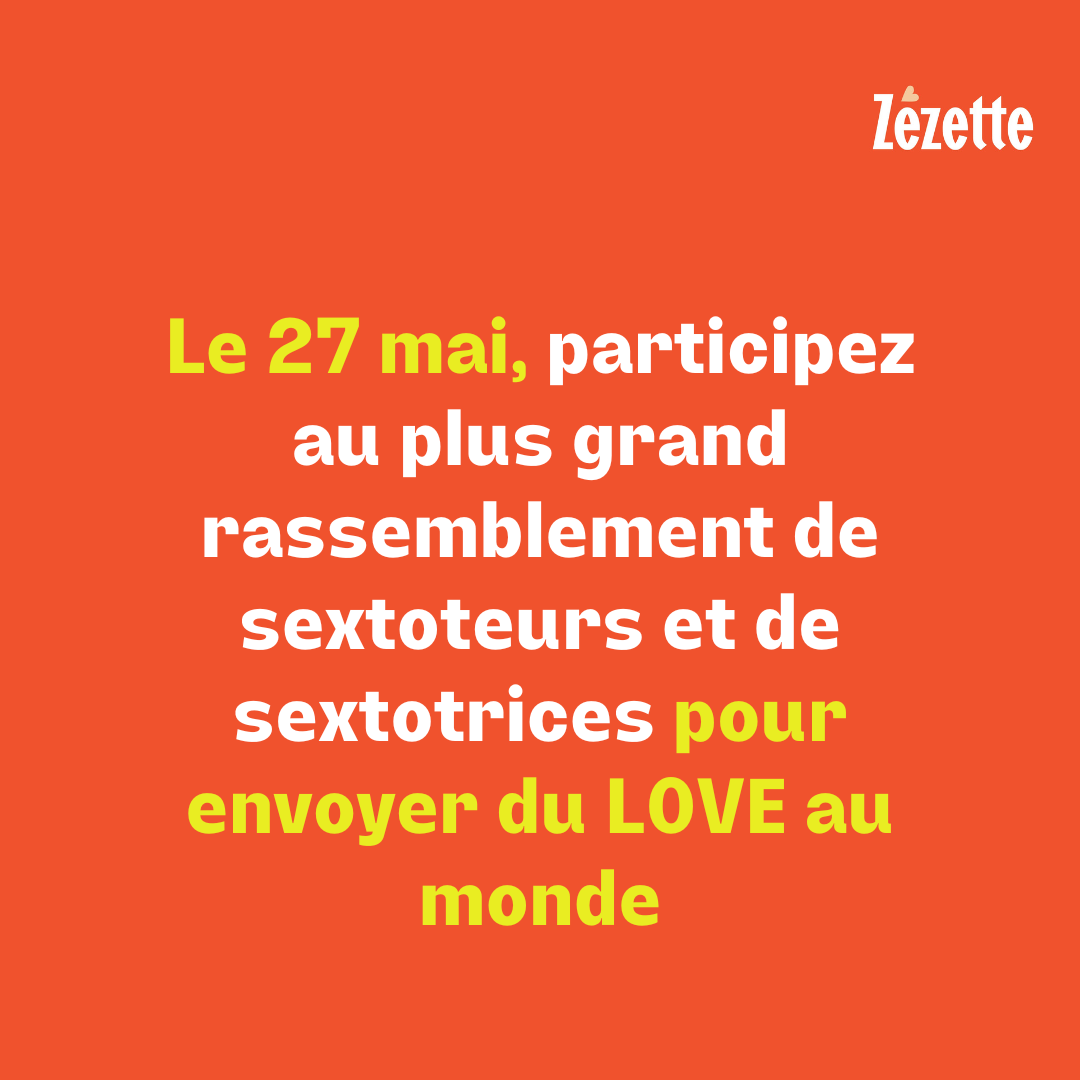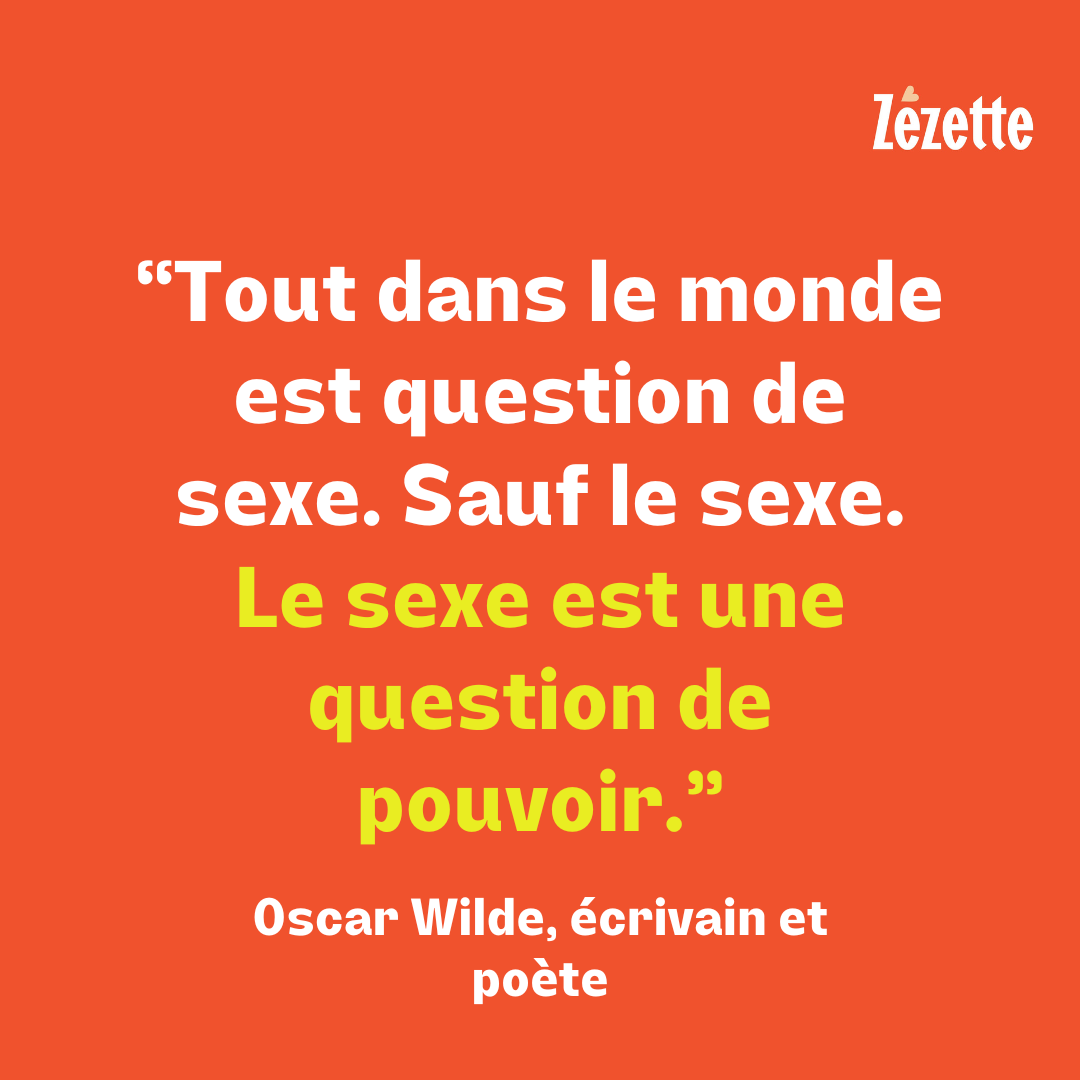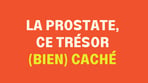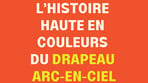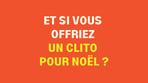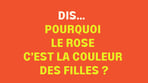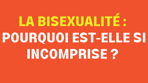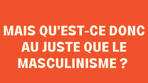Et si la poésie changeait notre vision du monde… et de la sexualité ?
On dit souvent qu’on a qu’une vie et pourtant, Samuela Burzio en compte déjà plusieurs. Avocate de formation, elle a parcouru le monde en train et vient de fonder une école de poésie, EPOE, pour permettre à chacun.e de mieux exprimer ses désirs. Elle explique à Zézette pourquoi selon elle la poésie sauvera le monde.


Lorsqu'on pense poésie on se figure Baudelaire, Rimbaud, Louise Labé. On ne pense ni à soi-même, ni au voisin, ni à sa collègue de bureau. Pourtant vous, vous considérez que l'on peut faire de la poésie un langage universel. Expliquez-nous ?
Samuela Burzio : On associe souvent la poésie aux textes que nous avons étudiés et appris par cœur à l’école. C’est beau mais c’est limité. Car la poésie va bien au-delà d’un simple genre littéraire. Elle incarne une posture. Le mot poésie vient du grec ancien poïésis qui signifie faire, créer. C’est donc un champ infini de libre expression. Rimbaud parlait d’ailleurs de “liberté libre” dans la vie et dans l’écriture.
Vous avez bien dit liberté libre ?
Oui ! Dans le sens de liberté absolue. Le poète joue avec la langue, avec les mots. Il y a une forme de résistance, d’insoumission aux règles. J’aime dire “On est des poètes, on fait ce qu’on veut” dans les ateliers que j’anime. Symboliquement c’est fort ; ça veut dire s’affranchir du cadre, sauter dans l’inconnu, ne pas avoir peur de l’originalité, de surprendre, de troubler. Le poète est cette femme ou cet homme qui dit l’invisible et ose dire l'indicible. Qui va au-delà des apparences et l’exprime. Qui met en mots ses émotions, ses sensations. Christian Bobin affirmait : “Il n’y a que les poètes qui prennent le monde au sérieux”. Pour moi, il exprime là l’enjeu des enjeux qui est de prêter attention à ce qui est autre que soi dans un contexte de crise sociale, écologique et politique, et d’y prendre soin. La poésie est une manière d’être au monde.
Les yogis diraient vivre la vie en pleine conscience…
La méditation et la poésie ont quelque chose en commun selon moi. Dans l’imaginaire collectif, on voit le poète comme un étourdi qui vit dans les nuages. J’en ai une vision totalement différente. Pour moi le poète est une personne profondément ancrée dans le réel.
Pourquoi avoir fondé l'école de poésie EPOE et à qui s'adresse-t-elle ?
C’est une école qui s’adresse à toutes et à tous. Je l’ai fondée comme une réponse à la crise sociétale et écologique que l’on traverse. Nos repères sont secoués de toutes parts et il nous faut penser des futurs désirables, susciter l’émerveillement et l’enchantement. Or, chez les humains, les métamorphoses passent par le langage. Ce qui rejoint le propos de la poétesse Audre Lorde, à savoir que “la poésie n’est pas un luxe, c’est une nécessité vitale”. On n’est pas dans l’ornemental. On ne cherche pas nécessairement la beauté des rimes, mais plutôt une connexion, une reliance. J’aime bien dire à ce titre que la poésie sauvera le monde ! Je m’inscris dans une forme de tendresse radicale.
On est proche de la visualisation positive, une technique utilisée notamment par les sportifs de haut niveau…
C’est ça. Si on veut changer le monde, il faut avoir une vision, il faut le rêver d’abord. Et on a besoin de mots pour ça. Pour créer le changement, le désir, le plaisir, la joie et la créativité sont nos meilleurs alliés plutôt que la peur et la culpabilité. Le but d’EPOE, qui est la contraction de « émergences poétiques », est d’ouvrir des espaces pour créer et s’exprimer. Et pour y parvenir, cela implique notamment de créer un cadre qui invite à ne pas se juger et à dépasser l’injonction de performance du monde dans lequel on vit.
Avec EPOE, vous intervenez notamment en entreprise. Ce n’est pas vraiment le lieu où l’on attend le poète…
Pourtant pour moi l’entreprise est un lieu qui a énormément besoin de poésie pour répondre à la fois aux enjeux de bien-être et d’innovation. Écrire de la poésie, c’est sortir du cadre ; ça mobilise des zones du cerveau impliquées dans la créativité et cela favorise la pensée divergente ainsi que nos capacités à trouver d’autres moyens de résoudre les problèmes. Cela peut aussi révéler des talents qui n’osent pas s’exprimer. A l’avenir, j’espère voir de plus en plus de poètes d’entreprise.
Le 14 janvier, pour le lancement de Zézette, vous avez animé un atelier haï-Q pour apprendre à mettre de la poésie dans ses sextos. Selon la définition publiée au Journal officiel en décembre 2013, le sexto est "un message multimédia ou minimessage à caractère sexuel" et a pour synonyme "texto pornographique". Et vous, quelle serait votre définition en tant que poétesse ?
Le sexto, pour moi, est une manière d’aimer les gens. Quand vous me dites sexto, il y a un monde qui s’ouvre devant moi. Le sexe est un univers infini à expérimenter qui va bien au-delà de la génitalité. D’ailleurs, le sexto n’est pas forcément un désir qui doit être assouvi, c’est un vecteur de plaisir en soi. C’est une manière de se connecter à l’autre. On n’est pas dans la prédation. C’est écrire le désir, l’exprimer, essayer de le susciter chez l’autre tout en étant dans une posture d’écoute. Le sexto porte une dimension politique forte. Lorsque je sextote, je peux me demander de quels mots j’ai envie, quels mots me touchent, m’excitent, quels mots vont me rapprocher de l’autre ou m’en éloigner. J’explore mes limites et mes fantasmes. Un sexto se lit avec la peau. Il faut y mettre de l’amour.
En quoi un sexto constitue-t-il un acte politique ?
Parce qu’il s’agit d’un espace où l’on s’affirme et par lequel on exprime un désir à quelqu'un. Mon corps, mon choix. Je suis vu.e dans l’expression de mon désir et je laisse à l’autre la possibilité d’exprimer le sien, de me dire oui ou non, de me partager ses limites. Le sexto permet de sortir du silence tout en respectant et en explorant le consentement.
Dans son livre Peut-on encore être galant ?, la professeure de littérature Jennifer Tamas revient à l'origine de la galanterie au XVIIe siècle, c’est-à-dire un mouvement culturel qui repose sur la conversation et l’égalité entre les sexes. Elle la définit comme "une mise à distance des pulsions qui, en plus de faire tomber le rapport de force, comporte une dimension intellectuelle et spirituelle. On s’adresse à l’intelligence de l’autre. Ce qu’on cherche à toucher, ce n’est plus le corps mais l’intellect." N'est-ce pas cela aussi la philosophie des haï-Q ?
En effet. Avec les haï-Q, on s’inscrit bien dans le plaisir intellectuel et spirituel. Il faut d’ailleurs avoir en tête que le cerveau est le premier organe sexuel.
Pouvez-vous nous rappeler ce qu’est un haïku, dont dérive le haï-Q ?
Il s’agit d’un poème court qui apparaît dans la poésie japonaise au XVIIe siècle. Il se compose de trois vers et, dans sa forme classique, de 17 syllabes. Le haïku retranscrit un instant : un oiseau qui traverse le ciel, une libellule qui se pose sur un saule pleureur. Il consiste à regarder ce qui se passe et le restituer de manière très courte, comme une sensation qui nous traverse. Trois vers, comme trois petits coups de pinceaux. On n’est pas dans le saule pleureur qui me fait penser à mon ex et qui fonctionne comme un support émotionnel pour moi. Avec le haïku, on accorde de l’importance à ce qui est autre que soi. On en fait un sujet et non un objet. On ne chosifie plus, ni un arbre ni une personne. Le haïku est une connexion au vivant.
Et donc qu’est-ce qu’un haï-Q ?
J’ai employé ce jeu de mots pour la première fois lors d’une scène ouverte. On utilise la forme du haïku, concise, suggestive, pour écrire des poèmes érotiques courts. La contrainte, être bref, permet de canaliser notre imagination et stimule la créativité.
Le 14 janvier à l’atelier haï-Q, les hommes étaient plus nombreux que les femmes. Une preuve selon vous que la masculinité peut s'exprimer autrement qu'à travers les codes du virilisme ?
J’espère bien ! C’est positif. Même si l’on peut aussi se demander pourquoi les femmes sont venues moins nombreuses. En tous cas, j’espère que de plus en plus de femmes vont oser s’exprimer et que de plus en plus d’hommes vont oser travailler leur sensibilité pour déconstruire le virilisme.
Selon le philosophe Guillaume Durand, auteur de Sexe et tabous, quasiment tous les tabous sont liés à la sexualité, d'où la difficulté de mettre des mots. Or vous dites que la poésie permet de se libérer des entraves du mental. La poésie est-elle le secret d'une sexualité épanouie ?
La poésie est une manière de sortir des tabous et des silences. En cela, elle est au service des sexualités créatives. Par ailleurs, qui dit poésie dit imaginaire et il est important de questionner nos représentations de la sexualité, surtout lorsqu’elles ont pu être polluées par des plateformes comme YouPorn et le délire de la domination masculine. Aujourd’hui, on a accès à des podcasts, à des médias, à tout un tas de moyens d’expression qui permettent de se construire un imaginaire positif, un imaginaire de dialogue, un imaginaire d’exploration et d’émancipation.
Avez-vous en mémoire quelques haï-Q du 14 janvier qui vous ont marquée et que vous pouvez nous partager ?
Malheureusement je n’ai pas pris de notes mais il y a eu des pépites incroyables. Je suis toujours surprise de ce qui sort de l’imaginaire des gens en l’espace de seulement deux heures. La poésie ça fait de la magie ! J’ai envie de conseiller le recueil Petites pièces d’amour de Habashli Kunzeï. Il y compose des haïkus érotiques avec beaucoup de douceur. En voici deux qui me touchent, et qui portent une référence à la saison comme les haïkus classiques : Buée sur la fenêtre / Paysage de neige / Ton dos nu et Ma bouche sur ton corps / Le bruit du vent / Les premières giboulées.
Et vous, quel est le haï-Q de votre composition que vous pourriez nous partager ?
Je peux vous partager celui-ci qui parle beaucoup de moi : Matin / Les rêves se dispersent / Mon corps cherche ta peau. J’ai aussi envie d’en citer un autre qui m’est venu lors d’une scène ouverte en pensant à une poétesse qui disait qu’il fallait toujours parler de sexe, et le faire de manière crue. Et c’est vrai, on n’est pas obligé.e de passer toujours par des métaphores ! C’est ce que j’ai fait ce soir-là en déclamant ceci : Baise-moi cette nuit / Baise-moi demain aussi / Baise-moi toute la vie. On a bien ri.
Infos pratiques : stage “Ecrire Eros” du 10 au 14 juillet à la Ferme de Peuton en Mayenne. Plus d’infos sur ecole-epoe.org
Propos recueillis par Blanche Lombardi
En mai, fais ce qu’il te plaît
Après l’atelier haï-Q du 14 janvier pour apprendre à mettre de la poésie dans ses sextos, Zézette, avec la poétesse Samuela Burzio et make_sense, organise le plus grand rassemblement de sextoteurs et de sextotrices le 27 mai à la Gaïté Lyrique à Paris pour envoyer du LOVE au monde. On vous en dit plus bientôt !
Mais pourquoi donc Zézette ?
Tout simplement (attention scoop…) parce qu’en 2025, il n’existe toujours pas de média consacré à la sexualité, et ce bien qu’il s’agisse de l’un des rares sujets au monde qui nous concerne tous. On trouve pourtant des journaux sur à peu près tout. Les camping-caristes ont ainsi leur magazine, Camping-car Magazine, depuis 1978, et les mostrophilistes (c’est comme cela que se font appeler les collectionneurs de montres) peuvent feuilleter Montres magazine depuis près de 30 ans.
Même si le sujet s’est fait une place dans les médias ces dernières années et que des voix de plus en en plus nombreuses se font entendre, la sexualité reste désespérément vierge de toute publication (en dehors des seules revues médicales qui lui sont consacrées...).
Puisque, dixit Oscar Wilde, « tout dans le monde est une question de sexe, sauf le sexe qui est une question de pouvoir », l'enjeu est de parvenir à parler sexualité sans honte comme de n’importe quel autre sujet. Car il s’agit bien d’explorer toutes ses facettes, notamment pour décortiquer les rapports de domination entre hommes et femmes.
C'est la raison d'être de Zézette, 1er média indépendant 100 % dédié à la sexualité avec pour but d’en faire un sujet de conversation que l’on ne se sent plus gêné d’aborder. Le principe : une newsletter envoyée au moins deux dimanches par mois, et plus si affinités…
Zézette, c’est aussi sur Instagram. Pour s’abonner, c’est ici